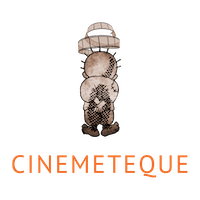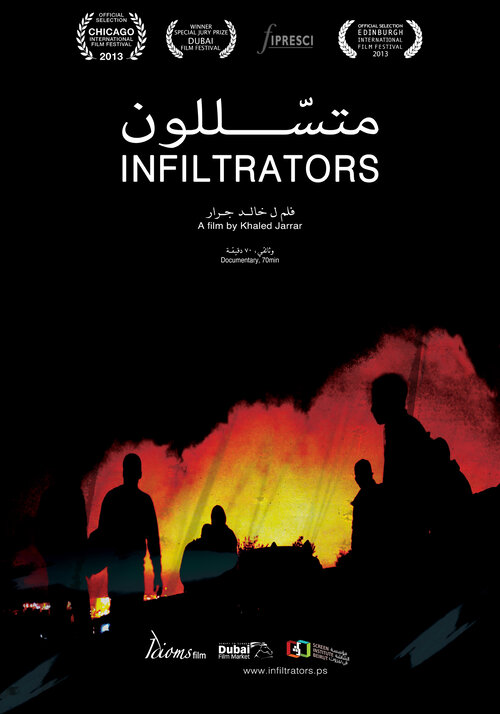BERNARD FAVIER
Biographie
CHRONIQUEUR RADIO
Ma vie de spectateur de cinéma a commencé dans mon enfance avec un film Disney : Bambi . Il m’a fallu attendre assez longtemps pour comprendre que ce séduisant film d’animation très lacrymal devait la fascination qu’il exerça sur moi à l’habileté graphique de Disney mais également au petit fonds documentaire, donc d’un petit peu de réel, que traçait le film dans sa forme de conte pour enfant. Ensuite à l’adolescence et avant d’aller au cinéma j’ai beaucoup lu sur des films, avant de les voir, et être parfois déçu au moment de la rencontre. Adulte, je suis devenu un cinéphile avec tous les engouements et les détestations déterminés par les films que je voyais. Pour résumer plutôt Cahiers du cinéma que Positif, revue trop littéraire pour moi.
Autour des années quatre vingt dix une possibilité s’est offerte à moi de pouvoir quitter mon boulot de professeur dans le secondaire, pour programmer et diriger une salle de cinéma art et essai. Je me suis adonné avec passion à mon rôle de passeur pour reprendre le beau terme inventer par Serge Daney, pour désigner ceux et celles qui programment, avec rigueur et passion, des films. Pour parfaire les échanges et le soutien aux films, je me suis retrouvé au sein du Groupement National des Cinémas de Recherche pour des moments de travail consacrés à des visionnages, des discussions et des projets.
Enfin, j’ai été à la direction artistique du festival du documentaire de Marseille, Vue Sur Les Docs, pendant 2 ans, période durant lesquels programmer à l’international fut une expérience passionnante.
Je vous propose ici une réflexion articulée autour de trois films sur le cinéma palestinien comme cinéma engagé.
Avant d’aborder mon sujet : « Le cinéma palestinien, un cinéma engagé », je vais tenter de traduire : ce que désigne un film dit « engagé », tenter d’en cerner les contours et déduire si sous ce label nous serions en présence d’un genre cinématographique.
D’abord la démarche : en amont du tournage, les cinéastes braquent leurs regards sur des événements dont ils interrogent les causes et leurs conséquences. Plusieurs questions se bousculent : qu’est-ce qui va induire pour les spectateurs cet engagement ? Est-ce la thématique du film ? L’intention du réalisateur ? Ou la coexistence des deux ? Ou encore un projet global, qui en amont aurait rencontré une matrice, comme une marque de fabrique, une sorte de geste conceptuel dans lequel entrerait thématique, réalisateur, acteurs, militants, pour arriver à l’objet, film engagé ?
Ce cinéma au moment de sa diffusion consisterait à questionner le spectateur. Est-ce qu’il s’accorde à ce qu’il voit ? Mais également est-ce-que ce cinéma l’interroge sur la portée de ce qui se passe sur l’écran, éveille sa curiosité à l’égard des informations sans omettre une forme de participation active ?
Il y a toutefois un cas, comme nous le verrons pour le cinéma palestinien, qui, répondant à ces critères, choisit une autre voie certainement la plus engagée : c’est le cas de ceux qui ont vécu ou vivent les situations, qui se saisissent d’une caméra, et réalisent eux-mêmes leur film.
Enfin, en conclusion de cette approche il y aurait comme une contrepartie à l’engagement social, politique ou militant du cinéma engagé, qui ne pourrait se dérober à une question essentielle, celle de l’engagement cinéma, et ces quelques critères. Nature et rectitude du filmage, nature également des émotions convoquées, car que pouvons-nous opposer au slogan : « qu’importe le flacon pourvu qu’on est l’ivresse » ?
En effet, le cinéma est porteur d’émotions et il n’est pas rare que celles-ci déterminent le choix des spectateurs au nom de ce que pointe Walter Benjamin dans « l’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », lorsqu’il évoque le comportement progressiste du public des années trente face aux films, le même qui, regardant une toile de Picasso, tournaient les talons. Il écrit que pour ce public qui a intégré le cinéma : « le plaisir émotionnel et spectaculaire se confond immédiatement et intimement avec l’attitude de l’expert ». En un mot, la difficulté de convaincre un spectateur sensible à un film racoleur de l’inanité de celui-ci.
En résumé un film engagé est un film comme n’importe quel film s’il ne joue pas d’effets démagogiques ou s’il ne décline pas un sentimentalisme échevelé. Il serait alors un genre cinématographique plein et entier.
Enfin une dernière question reste au débat à laquelle je ne répondrai que partiellement aujourd’hui. Le cinéma engagé est-il strictement l’affaire du cinéma documentaire ?
Le cinéma palestinien, un cinéma engagé ?
La cinématographie palestinienne est à coup sûr une de celles qui peuvent s’approprier, sans contredit, ce qualificatif. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu’un pays occupé comme l’est la Palestine ne peut pas réaliser des films qui nous conteraient les aventures d’un pays en paix. L’ensemble des films palestiniens évoque cette occupation. Je vais en choisir trois et voir au regard des critères de mon préambule comment ils s’articulent autour de la question du cinéma engagé. Le plus emblématique est certainement le film de Emad Burnat : Cinq Caméras Brisées.
Je souhaite évoquer ici, telle une exception qui confirme la règle, un film de fiction qui coche, sans nul doute, la case cinéma engagé. It must be Heaven, dernier film d’Elia Suleiman sorti en 2019 qui, l’air de rien, revendique haut et fort que nous devrions nous soucier, également haut et fort, de la Palestine.
Dans cette comédie dramatique, un personnage keatonien, joué par le réalisateur lui-même, traverse le film dans une position d’observateur du monde empruntée au personnage d’Handala du caricaturiste politique Naji al-Ali. Personnifiant le peuple palestinien, Handala est un enfant qui se promène toujours les mains croisées dans le dos, contemplant les malheurs issus de l’occupation de son pays. Il n’acceptera de se retourner que lorsque son peuple aura un Etat. Nous pouvons l’apercevoir au début du film sur un mur à Nazareth. Non sans nous remémorer les caricaturistes de Charlie Hebdo, Naji al-Ali fut assassiné à Londres le 22 juillet 1987 par les services secrets israéliens à la suite de quoi, Margaret Thatcher fit fermer les bureaux du Mossad à Londres.
Vous pouvez écouter ici la chronique que j’ai consacré à ce merveilleux film d’Elia Suleiman, It must be Heaven, sur WRZ la Web Radio Zibeline.
Cinq Caméras Brisées
Ce film nous introduit chez Emad Burnat, un cultivateur palestinien de Bil’in en Cisjordanie, qui a filmé de 2005 à 2010, depuis son village de 1.700 habitants, la lutte pacifique des habitants contre l’extension d’une colonie israélienne voisine et contre l’édification d’un mur les privant d’une partie conséquente de leurs terres et dont le projet annexe était d’empêcher toute infiltration dans la colonie de Modi’in Illit, prévue pour 50.000 résidents.
Emblématique, son film en cinq périodes, celles du bris des caméras rendues inutilisables par la violence de l’armée israélienne, nous raconte la lutte du village contre l’arrivée des occupants et l’intrusion permanente de jour comme de nuit, de l’armée israélienne dans leur village.
Pourtant tout a commencé avec le désir d’Emad de réaliser un film de famille à l’occasion de la naissance de son quatrième fils Djibril en 2005. En effet, nous verrons grandir le petit Djibril dans un film dans lequel d’autres acteurs le rejoindront.
Tous les vendredis, après la prière, les hommes du village décident de manifester en direction de la colonie qui va les spolier. Chaque vendredi l’armée israélienne les attend et les disperse avec des tirs de grenades lacrymogènes. Les hommes du village décident de transporter une caravane de guet à la limite de l’expropriation. Cette caravane sera systématiquement enlevée par une grue militaire. Alors puisque la loi israélienne dit qu’une bâtisse en dur ne peut pas être détruite les hommes du village construisent en une nuit un abri en parpaing de ciment. Nous mesurons le flegme d’Emad qui filme ces événements comme un témoignage irréfutable sur la violence et le non-respect des droits des Palestiniens.
A ses quatre ans, Djibril déclare à sa mère : Maman aujourd’hui c’est la première fois que je n’ai pas eu peur en allant à la manifestation. Mais l’armée débarque maintenant la nuit pour arrêter pendant leur sommeil tous les jeunes hommes qu’elle arrivera à attraper.
L’importance du cinéma et la force de son témoignage prennent corps et le film d’Emad va susciter l’intérêt d’un groupe professionnel. À la vue des rushes, un cinéaste israélien Guy Davidi qui venait soutenir le village dans ses actes de résistances suggère à Emad de faire de ses rushes un film. D’abord trouver une société de production. Ce qui fut fait. Ensuite une monteuse qui donnerait une cohérence à ces rushes. C’est Véronique Lagoarde-Ségot qui montera le film après huit semaines d’un intense travail. Cinq Caméras Brisées devient alors le film palestinien le plus engagé. Il sera nominé en 2013 aux Oscars dans la catégorie meilleur film documentaire.
Les Infiltrés
Je vais aborder maintenant un film tout aussi engagé que le dernier, Les Infiltrés de Khaled Jarrar. Artiste plasticien et cinéaste diplômé de l’Académie Internationale de Palestine, il entre dans l’armée pour payer ses études et devient garde du corps de Yasser Arafat jusqu’en 2004. Jarrar est né à Jénine en 1976 et il vit en Palestine.
Les Infiltrés dresse le portrait d’une société de jeunes Palestiniens qui se démènent pour contourner les check-points. Et si le check-point est fermé : « Détour ! Détour ! » crie le chauffeur du taxi qui annonce le début du voyage. Trouver inlassablement une faille à partir de laquelle s’infiltrer, un point faible dans la barrière électrifiée pour la couper et passer au travers, creuser un trou pendant des jours… Khaled Jarrar suit les Palestiniens qui, malgré le risque de lourdes sanctions, tentent quotidiennement de passer de l’autre côté du Mur pour aller travailler ou voir un parent proche.
« Pendant 4 ans, j’ai suivi des gens qui creusaient pendant des jours un trou sous le Mur, d’autres qui cherchaient un point faible dans la barrière électrifiée pour la couper et passer à travers, j’ai rencontré des contrebandiers, des familles brisées, des hommes et des femmes qui risquent l’emprisonnement, les blessures, la mort pour travailler « illégalement » en Israël… ils m’ont ouvert un autre monde dans lequel il est fascinant de voir l’ingéniosité des gens pour survivre, mener une vie normale, se jouer des théories sécuritaires israéliennes…montrer qu’il est impossible d’enfermer tout un peuple. »
Geste déterminant du cinéma engagé, Khaled Jarrar filme lui-même ces moments dangereux, ce qui veut dire qu’il prend les mêmes risques que ceux et celles qu’il filme et dans ce sens on peut dire que l’engagement est total car l’infiltration est le seul objet, la seule intention du film. Dans la plupart de ses œuvres, comme ici, Jarrar fait état de son militantisme. Il filme également les passeurs en préservant leur anonymat car leurs services sont rétribués de manière symbolique. Tout est bon pour passer parfois sous le mur, même d’énormes buses indispensables à l’écoulement de eaux de pluie mais très souvent obstruées par des rochers placés là à dessein.
Une femme et son bébé dans les bras sont du voyage avec opiniâtreté et courage. Ceux qui traversent le mur en connaissent aussi toutes les excavations et tous les trous permettant de faire passer des objets et même de la pâtisserie de l’autre côté. Mais le moment le plus triste et le plus émouvant n’est pas celui d’un passage mais simplement, l’apparition d’une main féminine, celle d’une mère que va serrer tendrement celle de sa fille, un geste presque sacré, seulement une main sortie sous le mur qui va en étreindre une autre, mère et fille réunies dans un moment d’affection en forme de pied de nez à l’occupant. Nous, spectateurs, sommes face à la quintessence de ce que peut réaliser le cinéma engagé. Mais cette séquence d’espoir sera vite effacée par le retour à la réalité quotidienne.
Nous apercevons un check-point, véritable couloir des supplices avec son cortège d’attentes et d’humiliations de la part de soldats qui n’ont été formés et modélisés qu’à l’usage robotique et disproportionné de la force.
Ford Tansit
Notre troisième film engagé est celui de Hany Abu-Assad, Ford Transit. Né à Nazareth, Hany quitte sa ville en 1980, pour s’installer au Pays-Bas, il a dix-neuf ans. À partir de 1998 il se consacre au cinéma. Ses principaux films sont : Omar, Paradise Now, Le chanteur deGaza. Il réside au Pays–Bas, mais ses films ont tous la Palestine comme terrain d’action, à l’exception d’une commande, La Montagne Entre Nous, réalisé pour la Fox.
Ford Transit est directement inspiré d’un détail : après la signature des accords d’Oslo, l’armée israélienne « récompensa » les Palestiniens qui avaient « collaboré » en leur offrant des vans Ford Transit. C’est dans le Ford Transit de Rajai, taxidriver de Ramallah à Jérusalem que Hany Abu-Assad a installé sa caméra. Le jeune Rajai va tenter d’éviter les check-points en empruntant des routes tortueuses et poussiéreuses comme celles que les gouvernements israéliens ont tracées pour les déplacements des Palestiniens à l’intérieur de la Cisjordanie occupée.
Au fil de ses vadrouilles et du chargement des clients, son taxi va devenir le petit théâtre des conversations sur les difficultés à se déplacer, mais aussi celles du quotidien, de la cruauté de l’occupation, ou de la justesse de résister. Dans ce petit théâtre mobile la parole va se débrider et Rajai ne sera pas le dernier à participer aux discussions dans lesquelles révolte et humour vont se côtoyer. Hany Abu-Assad filme sans fiel les degrés divers d’abattement et de révolte perceptible chez ses passagers palestiniens. Des personnalités prennent place dans le taxi comme la professeure d’université Hannah Achrawi ou le réalisateur américano-israélien B. Z. Goldeberg.
Mais, aux Pays–Bas, pays d’adoption du réalisateur, Ford Transit sera retiré des programmes du groupe audiovisuel néerlandais VPRO protestant et libre penseur. Cette chaîne a considéré que « ce film n’était pas un documentaire pur sucre parce qu’un soldat israélien brutal que le film présente est en réalité joué par un acteur palestinien ». Le film a provoqué de nombreux débats pour déterminer jusqu’où un documentaire devait-il être factuel. Nous sommes en présence d’un conflit un peu vain entre une façon très stricte d’approcher la réalité et une liberté que s’autorise le cinéaste qui ne va pas altérer la réalité vraie et vérifiable de ce qui va peupler son film.
Le cinéaste veut faire état de la brutalité des soldats israéliens. Brutalité envers les palestiniens, instiguée par la propagande dès l’école primaire et qui se décline en trois mots : Palestiniens tous terroristes.
L’alternative qu’il choisit fait hurler la chaine néerlandaise et elle cesse sa diffusion. Pourtant, dans nombre de documentaires, le casting existe, et donne lieu à une sélection lorsque les réalisateurs recherchent des personnages qui aiment suffisamment la caméra pour en faire les acteurs documentaires de leur propre vie. Le docu-fiction est devenu un genre souvent mi chèvre-mi chou qui tangue un peu à bâbord vers la fiction et à tribord vers le documentaire. Au final la seule approche fructueuse serait de débarrasser notre vision de conventions obsolètes, surtout dans le cas qui nous occupe, le cas de force majeure pour lequel ce soldat brutal est indispensable à Abu-Assad.
Qu’aurait dit la chaine néerlandaise, en voyant Nanouk l’Esquimau de Robert Flaherty un documentaire emblématique de 1922. Jean-Luc Godard raconte : « Quand on lit le récit du tournage de Nanouk de Flaherty, qu’on prend pour un documentaire, on apprend que Flaherty a payé ses Esquimaux, il s’est disputé avec eux, il les a forcés à pêcher du poisson tous les jours alors qu’ils n’en avaient pas envie, bref, il a fait une équipe de cinéma avec eux et ce fut du coup un ethnologue formidable. » Alors Hany Abu-Assad / Flaherty même combat ?
Selon moi, le « cinéma vérité » n’est rien d’autre qu’une construction mentale et Ford Transit un film engagé. Ford Transit peut être inscrit sans contredit au répertoire du cinéma engagé comme un film qui pour dire ce qu’il avait besoin de dire a dû user de ruse, tourné en catimini en créant un espace fermé indépendant à l’intérieur d’un van où la parole était libre.
Ford Transit a eu une descendance : Taxi Téhéran de Jafar Panahi, cinéaste iranien interdit de filmer dans son propre pays l’Iran. En 2015 Il reprend le principe du taxi studio et tourne Taxi Téhéran au volant d’un véhicule dans lequel montent et descendent des « clients » qui ont tous quelque chose à dire sur le régime. Ford Transit et Taxi Téhéran : deux films engagés.
Nous pouvons dire que la quasi-totalité des films palestiniens sont aujourd’hui des films engagés, pas par choix mais parce que la situation de l’occupation violente de leur pays ne peut déployer une toile de fond de récits sur une liberté de vivre qui leur est confisquée. Leur unique choix : la résistance. Les cinéastes palestiniens de l’intérieur ou de la diaspora Emad Burat, Khaled Jarrar, Elia Suleiman, Annemarie Jacir, Hany Abu-Assad, Rashid Masharawi, s’agrègent tous aux mots prononcés par Hany Abu–Assad lors d’un entretien à la sortie de Paradise Now :
« Je me battrai toujours contre l’injustice, je ferai toujours de la résistance. Mais pas avec des armes, pas en tirant des coups de feu. Je suis partisan de ce qu’on appelle la résistance passive. La résistance la plus efficace qui soit à ma portée c’est le boycott culturel. Evidemment si un distributeur israélien veut acheter mon film, et le montrer en Israël nous n’avons aucune objection. Mais je ne participerai jamais à aucun festival à aucune projection qui représente les institutions israéliennes ».